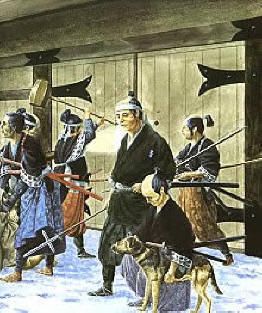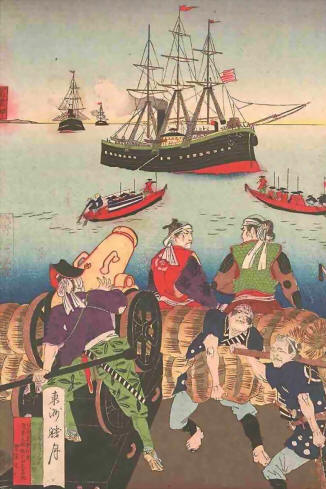Edo jidai (1616-1867)
L'instauration de la dictature de la
paix (1616-1651)
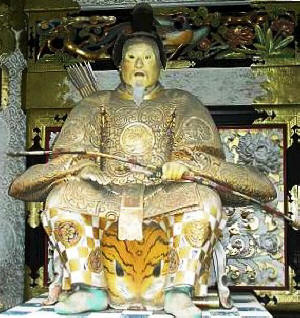 TOKUGAWA Ieyasu (1543-1616) devient shogun en 1603. Il fonde le troisième
shogunat (ou bakufu) japonais, celui des TOKUGAWA, dit aussi celui d'Edo,
d'après le nom de la ville (aujourd'hui Tokyo) de l'est de Honshu, où il
installe le centre de son autorité. Cette dernière éclipse dès lors Kyoto, la
cité impériale, dans son rôle de capitale et devient le vrai centre politique du
pays.
TOKUGAWA Ieyasu (1543-1616) devient shogun en 1603. Il fonde le troisième
shogunat (ou bakufu) japonais, celui des TOKUGAWA, dit aussi celui d'Edo,
d'après le nom de la ville (aujourd'hui Tokyo) de l'est de Honshu, où il
installe le centre de son autorité. Cette dernière éclipse dès lors Kyoto, la
cité impériale, dans son rôle de capitale et devient le vrai centre politique du
pays.
Théoriquement, le shogun TOKUGAWA est un dictateur militaire qui détient son
pouvoir par délégation de l'empereur du Japon. En réalité, c'est bien le premier
qui gouverne l'archipel, tenant le second et sa cour sous sa coupe et
l'obligeant à se contenter de vivre de revenus financiers relativement modestes.
La bataille de Sekigahara (1600) a rendu Ieyasu maître du pays. Ensuite, le
shogunat établit son administration directe sur de nombreux domaines. Les autres
fiefs sont redistribués aux seuls grands seigneurs féodaux (daimyo) ayant
soutenu Ieyasu. Outre Edo et Kyoto, le shogunat étend également sa domination
sur les grandes villes, souvent riches et commerçantes, comme Osaka, Sakai, Nara
et Nagasaki. Ieyasu et ses successeurs, son fils Hidetada (1579-1632) et son
petit-fils Iemitsu (1604-1651), renforcent le caractère autoritaire du régime et
le dotent de diverses institutions. Ainsi, le shogun est assisté par un "conseil
des anciens" (roju), de cinq membres, présidé par un "grand ancien" (tairo),
et appuyé par un conseil auxiliaire de "moins anciens" (wakadoshiyori).
Des préfets sont placés à la tête des grandes villes contrôlées directement par
le régime et un gouverneur surveille Kyoto.
sont placés à la tête des grandes villes contrôlées directement par
le régime et un gouverneur surveille Kyoto.
La grande décision du shogunat des TOKUGAWA demeure la fermeture du Japon aux
étrangers, progressive à partir de 1616, puis quasiment complète à partir de
1639. Elle va couper l'archipel du reste du monde pendant plus de deux siècles.
Dans un premier temps, les ports d'Hirado et de Nagasaki (Kyushu)
continuent à être ouverts. Puis, Portugais, Espagnols et Anglais, présents
depuis le début du XVIIe siècle avec les Hollandais, sont sommés de partir. En
1637, intervient l'insurrection des catholiques japonais de Shimabara (Kyushu),
réprimée dans le sang par les troupes du shogunat, aidées par les navires et les
canons des Hollandais, protestants. Ces derniers, confinés dans l'îlot
artificiel de Dejima, dans le port de Nagasaki, sont désormais les seuls
Européens autorisés à venir au Japon. Le christianisme y est à nouveau prohibé.
Tandis que les Japonais expatriés sont interdits de retour, l'archipel ne reçoit
plus que, quelques fois par an, la visite de quelques bateaux chinois, coréens
et hollandais dûment autorisés. Shimabara constitue d'ailleurs la dernière
grande manifestation de violence collective connue sous le shogunat.
Dans les affaires intérieures, le nouveau régime instaure sa dictature de la
paix. Afin d'en finir avec les anciennes divisions ré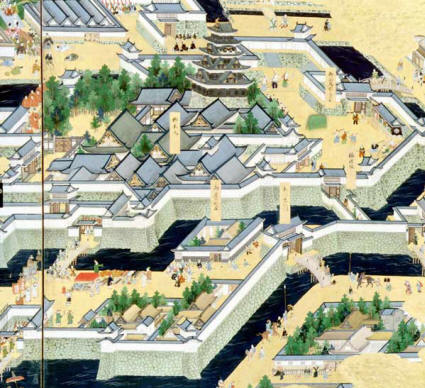 gionales, un contrôle
sévère s'exerce sur les daimyo. Ceux-ci sont inclus dans une hiérarchie en
fonction de leur degré d'alliance aux TOKUGAWA. Leur autonomie par rapport à
l'autorité centrale du shogun est supprimée par un système coercitif qui les
menace d'une plus ou moins grande disgrâce. Surveillés par des inspecteurs, ils
sont éventuellement punis par leur déplacement dans un fief au revenu moins
important, voire en sont privés ou obligés de se suicider. Leurs finances sont
affaiblies par le paiement des travaux du château shogunal édifié à Edo et
l'obligation de fournir des troupes.
gionales, un contrôle
sévère s'exerce sur les daimyo. Ceux-ci sont inclus dans une hiérarchie en
fonction de leur degré d'alliance aux TOKUGAWA. Leur autonomie par rapport à
l'autorité centrale du shogun est supprimée par un système coercitif qui les
menace d'une plus ou moins grande disgrâce. Surveillés par des inspecteurs, ils
sont éventuellement punis par leur déplacement dans un fief au revenu moins
important, voire en sont privés ou obligés de se suicider. Leurs finances sont
affaiblies par le paiement des travaux du château shogunal édifié à Edo et
l'obligation de fournir des troupes.
Ils sont aussi contraints à une "présence alternée" (sankin-kotai) d'une
année sur deux à Edo, où ils laissent leurs principales épouses et leurs
héritiers sous la menace du shogun durant l'année passée dans leurs domaines. Ce
devoir d'entretenir une double résidence, un seul château par fief, irréparable
sans autorisation, mais aussi un palais dans la capitale shogunale, est conçu
pour les appauvrir. Tout comme le fait de se déplacer vers Edo et en revenir
avec leur suite en un dispendieux cortège, le long de routes imposées, comme
celle du Tokaido, qui conduit de Kyoto à Edo en 53 étapes. Elle comporte
d'ailleurs autant de barrières où la police des TOKUGAWA vérifie les possibles
déplacements frauduleux d'armes, voire des femmes du daimyo, assujetti
jusque dans sa vie privée. En l'occurrence, il lui est même interdit de se
marier sans en référer au shogun...
En ce XVIIe siècle, le groupe des
guerriers représente 6 à 7 pour cent des Japonais. Il se distingue du reste de la
population (paysans, commerçants et artisans), sur lequel il a le droit de vie
et de mort, par le port de deux sabres, le long (katana) et le court (wakizashi).
En fait, le shogun TOKUGAWA a domestiqué cette classe et l'a organisée dans une
structure pyramidale. Il en constitue la tête avec, au-dessous de lui, les
daimyo, commandant et regroupant au sein de leurs clans respectifs ces
samurai. Ceux-ci se répartissent en différentes catégories en fonction du fief
ou du revenu dont ils ont l'usufruit en échange de leur fidélité à leur
seigneur. Ils obéissent à un code moral fixé à cette époque, le bushido
(voie des guerriers), prônant des valeurs de maîtrise de soi, de frugalité, de
chevalerie et de dévouement qui trouvent leur manifestation ultime dans le
suicide ritualisé (seppuku, appelé improprement en Occident hara-kiri).
Ce dernier va demeurer l'une des rares manifestations de violence individuelle.
En effet, une fois que le shogunat des TOKUGAWA a établi sa dictature de la
paix, il va réduire progressivement les samurai à devenir des guerriers
virtuels, maniant surtout le sabre de bois (développement du kendo). Le pouvoir,
bien que militaire à l'origine, va les inciter à se cultiver pour se transformer
en bureaucrates au service du régime.
et de dévouement qui trouvent leur manifestation ultime dans le
suicide ritualisé (seppuku, appelé improprement en Occident hara-kiri).
Ce dernier va demeurer l'une des rares manifestations de violence individuelle.
En effet, une fois que le shogunat des TOKUGAWA a établi sa dictature de la
paix, il va réduire progressivement les samurai à devenir des guerriers
virtuels, maniant surtout le sabre de bois (développement du kendo). Le pouvoir,
bien que militaire à l'origine, va les inciter à se cultiver pour se transformer
en bureaucrates au service du régime.
Vassaux de perdants de la bataille de Sekigahara ou de daimyo disgraciés
plus tard, certains samurai se transforment en errants sans maître, devenant des
ronin (littéralement hommes de la vague). Le shogunat interdit
d'ailleurs les suicides collectifs par fidélité après la mort d'un daimyo
destitué, qui tendaient à se généraliser. De plus en plus nombreux, ces
déclassés se font donc enseignants pour les plus instruits, artisans ou, plus
prosaïquement, brigands. Leur révolte est réprimée après la mort du shogun
Iemitsu (1651), puis ils finissent par se fondre dans le reste de la population.
En outre, les problèmes d'argent, qui vont devenir récurrents pour les TOKUGAWA,
commencent à apparaître avec les dépenses somptuaires occasionnées par la
construction des monuments funéraires des premiers shoguns de la dynastie à
Nikko (aujourd'hui au nord de Tokyo).
Apogée et déclin du shogunat des Tokugawa (1651-1853)
Du XVIIe au
 XIXe siècle, les TOKUGAWA ne vont pas cesser de se cramponner à leur
objectif premier de perpétuer leur régime. Dans ce but, ils ont imposé une paix
civile qu'ils voudraient maintenir par l'immobilisme politique et social à
l'intérieur de l'archipel nippon, et l'isolationnisme envers l'extérieur. Leur
conservatisme est conforté par l'adoption d'une idéologie officielle
néo-confucianiste, inspirée du modèle toujours présent de la Chine.
XIXe siècle, les TOKUGAWA ne vont pas cesser de se cramponner à leur
objectif premier de perpétuer leur régime. Dans ce but, ils ont imposé une paix
civile qu'ils voudraient maintenir par l'immobilisme politique et social à
l'intérieur de l'archipel nippon, et l'isolationnisme envers l'extérieur. Leur
conservatisme est conforté par l'adoption d'une idéologie officielle
néo-confucianiste, inspirée du modèle toujours présent de la Chine.
Cependant, le Japon tourne ainsi le dos au progrès technique et aux
développements qui naissent en Europe à l'époque de la Révolution industrielle.
Au contraire, parmi l'élite dirigeante de la classe des guerriers va continuer à
prévaloir l'idée, de plus en plus rétrograde, que l'agriculture et, surtout, la
production de riz, doivent demeurer les fondements de l'économie.
En dépit du blocage social, un exode rural très important grossit les
populations des grandes villes et y augmente la misère. Mais, à côté, une
bourgeoisie citadine (les chonin) s'y épanouit également. Elle profite de
l'essor du commerce, favorisé par la fin de la segmentation du Japon en fiefs de
daimyo imposant anciennement des entraves douanières. Cette situation
disparaît au profit de la constitution d'un grand marché intérieur et d'une
économie monétaire enfin étendue à tout le pays. Daimyo et samurai,
appauvris par le shogunat, vont d'ailleurs de plus en plus s'endetter auprès des
chonin et se lier à eux, notamment par le biais d'unions matrimoniales.
La prospérité des chonin est aussi à l'origine de l'émergence d'une nouvelle
culture, dite de
 l'ère Genroku. Plus frivole que celle
l'ère Genroku. Plus frivole que celle
 affectionnée par les
guerriers, elle connaît son sommet au tournant du XVIIe siècle et s'épanouit
dans les quartiers des plaisirs, comme Yoshiwara à Edo. Ce "monde flottant" est
notamment le domaine de la geisha, courtisane et aussi experte dans la pratique
de divers arts, la musique notamment. Les auteurs d'estampes et de xylogravures
sont inspirés par des thèmes de cette culture urbaine dont deux des fleurons
sont le théâtre Kabuki et la vogue des poèmes haiku.
affectionnée par les
guerriers, elle connaît son sommet au tournant du XVIIe siècle et s'épanouit
dans les quartiers des plaisirs, comme Yoshiwara à Edo. Ce "monde flottant" est
notamment le domaine de la geisha, courtisane et aussi experte dans la pratique
de divers arts, la musique notamment. Les auteurs d'estampes et de xylogravures
sont inspirés par des thèmes de cette culture urbaine dont deux des fleurons
sont le théâtre Kabuki et la vogue des poèmes haiku.
Pendant ce
temps, après un début de "règne" prometteur, apogée du régime des TOKUGAWA, le
shogun Tsunayoshi (1646-1709) laisse la situation péricliter. Ses prédécesseurs
avaient, certes, pris le contrôle des gisements de métaux précieux (or et
argent) du pays et s'étaient attribués le droit exclusif de battre monnaie.
Mais, face à des difficultés financières persistantes, lui et ses successeurs
vont devoir prendre des mesures répétées de dévaluation et d'augmentation de la
pression fiscale. Tsunayoshi, bouddhiste fervent préoccupé de la protection des
êtres vivants plus faibles dans lesquels on est susceptible de se réincarner, se
signale par son amour exagéré des chiens. Ce qui lui vaut d'être moqué. Il finit
d'ailleurs fou et assassiné par sa femme...
En 1701-170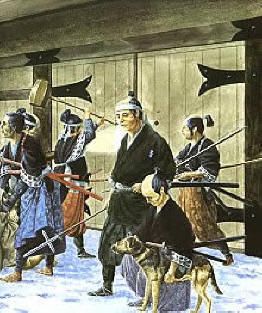 3 vient se placer l'incident des quarante-sept ronin. Ils attendent
deux ans dans la dissimulation de pouvoir venger leur ancien maître, un daimyo
contraint au suicide par les manigances d'un dignitaire de la cour du shogun.
Leur vendetta défiant l'ordre public accomplie, ce dernier les autorise
néanmoins à se faire seppuku. Leur déjà presque anachronique expression de
l'esprit de chevalerie et de fidélité de vassaux envers leur suzerain marque
pourtant durablement les esprits.
3 vient se placer l'incident des quarante-sept ronin. Ils attendent
deux ans dans la dissimulation de pouvoir venger leur ancien maître, un daimyo
contraint au suicide par les manigances d'un dignitaire de la cour du shogun.
Leur vendetta défiant l'ordre public accomplie, ce dernier les autorise
néanmoins à se faire seppuku. Leur déjà presque anachronique expression de
l'esprit de chevalerie et de fidélité de vassaux envers leur suzerain marque
pourtant durablement les esprits.
Quoi qu'il en soit, le Japon continue à vivre replié sur lui-même, avec une
économie essentiellement agricole. Or, entre le début et la fin du shogunat, la
population est multipliée par trois, pour atteindre plus d'une trentaine de
millions d'habitants, tandis que les rendements ne suivent pas toujours. Le sort
des paysans ne va pas s'en trouver amélioré. Les famines vont donc se répéter, y
compris dans la première moitié du XIXe siècle, avec leur lot de rébellions
impitoyablement réprimées s'étendant parfois aux villes.
À cela s'ajoutent diverses catastrophes naturelles. À commencer par plusieurs
incendies ravageant Edo, première ville du monde par sa population et longtemps
construite en bois. Sans parler des tremblements de terre, comme celui du Kanto,
en 1703, ou des éruptions volcaniques, dont la dernière touchant le mont Fuji,
en 1707.
Le shogun Yoshimune (1684-1751) tente bien par des mesures énergiques de réduire
les crises rurales et la pauvreté des campagnes. Il allège également les
restrictions qui pèsent sur la circulation des livres étrangers, facilitant
l'épanouissement des "études hollandaises" (rangaku). Les Hollandais restent les
seuls étrangers autorisés à des contacts parcimonieux avec les Japonais,
constituant leur principale source d'information sur les techniques nouvelles,
les sciences modernes et la médecine. À l'inverse, une autre école
d'intellectuels nippons (wagakusha) remet à l'honneur le shinto et les anciens
mythes sur l'ascendance divine de l'empereur. Elle annonce un nationalisme en
devenir et un mouvement favorable à la restauration du pouvoir impérial qui va
remettre en question l'existence même d'un shogun.
Cependant, la pression sur les frontières toujours fermées de l'archipel se fait
de plus en plus forte de la part des puissances occidentales colonialistes.
Entre autres, les Britanniques, menaçants champions du Libre Échange, viennent
de s'ouvrir le marché de la Chine avec leurs canonnières suite aux Guerres de
l'opium (1839-1842). De même, les Français s'intéressent aux îles Ryukyu, au sud
du Japon, tandis que les Russes convoitent la nordique Ezo (la future Hokkaido),
alors seulement partiellement entrée dans le giron du shogunat.
Fin du shogunat des
Tokugawa (Bakumatsu,1853-1867)
Après presque 250 ans de soumission collective, passés à l'écart du reste du
monde, le Japon, enc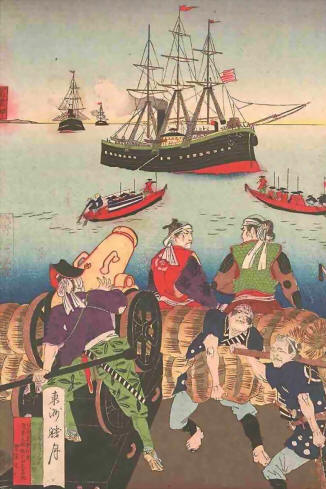 ore partiellement plongé dans la féodalité, est brutalement
contraint à l'ouverture. Cet évènement se solde par la capitulation du shogunat
(ou bakufu) des TOKUGAWA face aux exigences étrangères. Il va provoquer une
crise de confiance à l'intérieur du pays qui va précipiter la fin du régime, à
l'issue d'une période troublée appelée Bakumatsu
ore partiellement plongé dans la féodalité, est brutalement
contraint à l'ouverture. Cet évènement se solde par la capitulation du shogunat
(ou bakufu) des TOKUGAWA face aux exigences étrangères. Il va provoquer une
crise de confiance à l'intérieur du pays qui va précipiter la fin du régime, à
l'issue d'une période troublée appelée Bakumatsu
 (la Fin du bakufu).
(la Fin du bakufu).
En 1853, profitant de la Guerre de Crimée qui occupe Anglais et Français, les
Américains, en pleine expansion dans le Pacifique, obtiennent la déclaustration
du Japon. L'officier de marine Matthew PERRY (1794-1858), au cours d'une
promenade militaire dans la baie d'Edo, exhibe quelques navires et leurs canons,
dont certains à vapeur. Le shogun en poste doit s'incliner face à la supériorité
technologique des étrangers et décide de traiter lors du retour des "vaisseaux
noirs", en 1854. Des accords commerciaux sont passés avec les États-Unis, leur
ouvrant deux ports : Shimoda (près d'Edo) où vient s'installer bientôt un consul
américain, Townsend HARRIS (1804-1878), et Hakodate (Ezo, aujourd'hui Hokkaido).
Très rapidement, d'autres puissances occidentales s'engouffrent dans la brèche à
la suite des Américains. Ainsi, outre les Hollandais déjà présents, Anglais,
Russes et Français se voient reconnaître des conditions commerciales favorables
pour s'établir au Japon. Certains ports comme Yokohama (maintenant près de
Tokyo) profitent de leur implantation pour se développer.
Néanmoins, la venue des étrangers divise les sphères dirigeantes japonaises en
deux camps. Les plus conservateurs et xénophobes v oudraient tout simplement s'en
débarrasser. On trouve parmi eux eux de jeunes samurai très dynamiques,
entraînés physiquement et bien éduqués, issus des couches les plus basses des
guerriers de clans éloignés géographiquement du pouvoir central du shogun à Edo.
C'est particulièrement le cas des hommes des fiefs de Choshu (extrême ouest de
Honshu) et de Satsuma (sud de Kyushu). Ces seigneuries, traditionnellement
résistantes au shogunat, se sont pourtant enrichies, malgré ses interdictions,
en continuant à faire du négoce avec la Chine et la Corée. Leurs samurai se
réclament de l'empereur, dont ils veulent faire le défenseur de l'indépendance
nationale. Ils se rapprochent dans ce but des princes de la cour impériale de
Kyoto qui sort d'un sommeil de nombreux siècles. En revanche, les plus
pragmatiques, shogun en tête, ont pris le parti de s'accommoder de l'intrusion
occidentale, au moins le temps d'apprendre d'elle comment moderniser le pays et,
en premier lieu, son artillerie et sa flotte.
oudraient tout simplement s'en
débarrasser. On trouve parmi eux eux de jeunes samurai très dynamiques,
entraînés physiquement et bien éduqués, issus des couches les plus basses des
guerriers de clans éloignés géographiquement du pouvoir central du shogun à Edo.
C'est particulièrement le cas des hommes des fiefs de Choshu (extrême ouest de
Honshu) et de Satsuma (sud de Kyushu). Ces seigneuries, traditionnellement
résistantes au shogunat, se sont pourtant enrichies, malgré ses interdictions,
en continuant à faire du négoce avec la Chine et la Corée. Leurs samurai se
réclament de l'empereur, dont ils veulent faire le défenseur de l'indépendance
nationale. Ils se rapprochent dans ce but des princes de la cour impériale de
Kyoto qui sort d'un sommeil de nombreux siècles. En revanche, les plus
pragmatiques, shogun en tête, ont pris le parti de s'accommoder de l'intrusion
occidentale, au moins le temps d'apprendre d'elle comment moderniser le pays et,
en premier lieu, son artillerie et sa flotte.
Leur différend va rapidement dégénérer et se régler en batailles rangées au
sabre dans les rues. Ainsi, des éléments conservateurs assassinent le "grand
ancien" (tairo) II Naosuke (1815-1860), négociateur des "traités
inégaux", pour eux la personnalité symbolique de la compromission avec les
étrangers. Les marines occidentales se livrent cependant à des démonstrations de
force contre les ports de Kagoshima (Satsuma) en 1862 et Shimonoseki (Choshu) en
1863-1864, suite à des actes d'hostilité des clans locaux. Elles obligent le
shogunat à de nouvelles concessions.
personnalité symbolique de la compromission avec les
étrangers. Les marines occidentales se livrent cependant à des démonstrations de
force contre les ports de Kagoshima (Satsuma) en 1862 et Shimonoseki (Choshu) en
1863-1864, suite à des actes d'hostilité des clans locaux. Elles obligent le
shogunat à de nouvelles concessions.
Partisans d'une restauration de l'empereur, clan de Choshu au premier rang, et
troupes shogunales comme la milice nommée shinsen-gumi, s'affrontent au cours de
diverses escarmouches. Ils se disputent notamment le contrôle de Kyoto. Face à
la progression des idées prônant le rétablissement du pouvoir impérial et à une
situation de guerre civile latente, le shogunat ne reste pas inactif. Il crée un
embryon d'armée moderne équipée de fusil. Mais les élites de Satsuma et de
Choshu font de même, tirant les leçons de leurs affrontements perdus contre les
Occidentaux. Elles mettent une sourdine à leur xénophobie et reçoivent l'appui
des Britanniques ! Dans le même temps, l'échec d'opérations militaires dirigées
contre ces fiefs récalcitrants de 1864 à 1866 conforte le parti pro-impérial. Le
dernier shogun TOKUGAWA, Yoshinobu (1837-1913), gouverne un an avant de devoir
renoncer à un pouvoir qu'il est censé détenir d'une délégation impériale. Le 9
novembre 1867, le shogunat est supprimé au profit d'une restauration de
l'autorité du jeune empereur Mutsuhito (nom posthume: Meiji, 1852-1912).
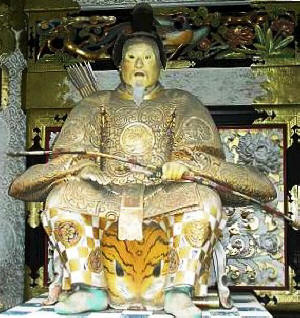 TOKUGAWA Ieyasu (1543-1616) devient shogun en 1603. Il fonde le troisième
shogunat (ou bakufu) japonais, celui des TOKUGAWA, dit aussi celui d'Edo,
d'après le nom de la ville (aujourd'hui Tokyo) de l'est de Honshu, où il
installe le centre de son autorité. Cette dernière éclipse dès lors Kyoto, la
cité impériale, dans son rôle de capitale et devient le vrai centre politique du
pays.
TOKUGAWA Ieyasu (1543-1616) devient shogun en 1603. Il fonde le troisième
shogunat (ou bakufu) japonais, celui des TOKUGAWA, dit aussi celui d'Edo,
d'après le nom de la ville (aujourd'hui Tokyo) de l'est de Honshu, où il
installe le centre de son autorité. Cette dernière éclipse dès lors Kyoto, la
cité impériale, dans son rôle de capitale et devient le vrai centre politique du
pays.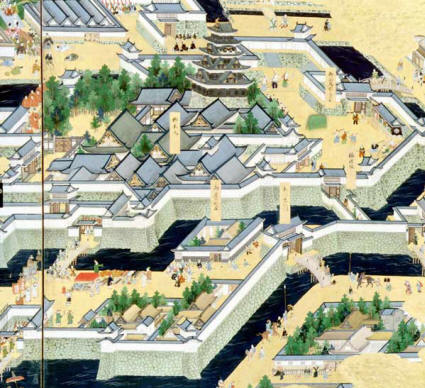 gionales, un contrôle
sévère s'exerce sur les daimyo. Ceux-ci sont inclus dans une hiérarchie en
fonction de leur degré d'alliance aux TOKUGAWA. Leur autonomie par rapport à
l'autorité centrale du shogun est supprimée par un système coercitif qui les
menace d'une plus ou moins grande disgrâce. Surveillés par des inspecteurs, ils
sont éventuellement punis par leur déplacement dans un fief au revenu moins
important, voire en sont privés ou obligés de se suicider. Leurs finances sont
affaiblies par le paiement des travaux du château shogunal édifié à Edo et
l'obligation de fournir des troupes.
gionales, un contrôle
sévère s'exerce sur les daimyo. Ceux-ci sont inclus dans une hiérarchie en
fonction de leur degré d'alliance aux TOKUGAWA. Leur autonomie par rapport à
l'autorité centrale du shogun est supprimée par un système coercitif qui les
menace d'une plus ou moins grande disgrâce. Surveillés par des inspecteurs, ils
sont éventuellement punis par leur déplacement dans un fief au revenu moins
important, voire en sont privés ou obligés de se suicider. Leurs finances sont
affaiblies par le paiement des travaux du château shogunal édifié à Edo et
l'obligation de fournir des troupes.
 et de dévouement qui trouvent leur manifestation ultime dans le
suicide ritualisé (seppuku, appelé improprement en Occident hara-kiri).
Ce dernier va demeurer l'une des rares manifestations de violence individuelle.
En effet, une fois que le shogunat des TOKUGAWA a établi sa dictature de la
paix, il va réduire progressivement les samurai à devenir des guerriers
virtuels, maniant surtout le sabre de bois (développement du kendo). Le pouvoir,
bien que militaire à l'origine, va les inciter à se cultiver pour se transformer
en bureaucrates au service du régime.
et de dévouement qui trouvent leur manifestation ultime dans le
suicide ritualisé (seppuku, appelé improprement en Occident hara-kiri).
Ce dernier va demeurer l'une des rares manifestations de violence individuelle.
En effet, une fois que le shogunat des TOKUGAWA a établi sa dictature de la
paix, il va réduire progressivement les samurai à devenir des guerriers
virtuels, maniant surtout le sabre de bois (développement du kendo). Le pouvoir,
bien que militaire à l'origine, va les inciter à se cultiver pour se transformer
en bureaucrates au service du régime.